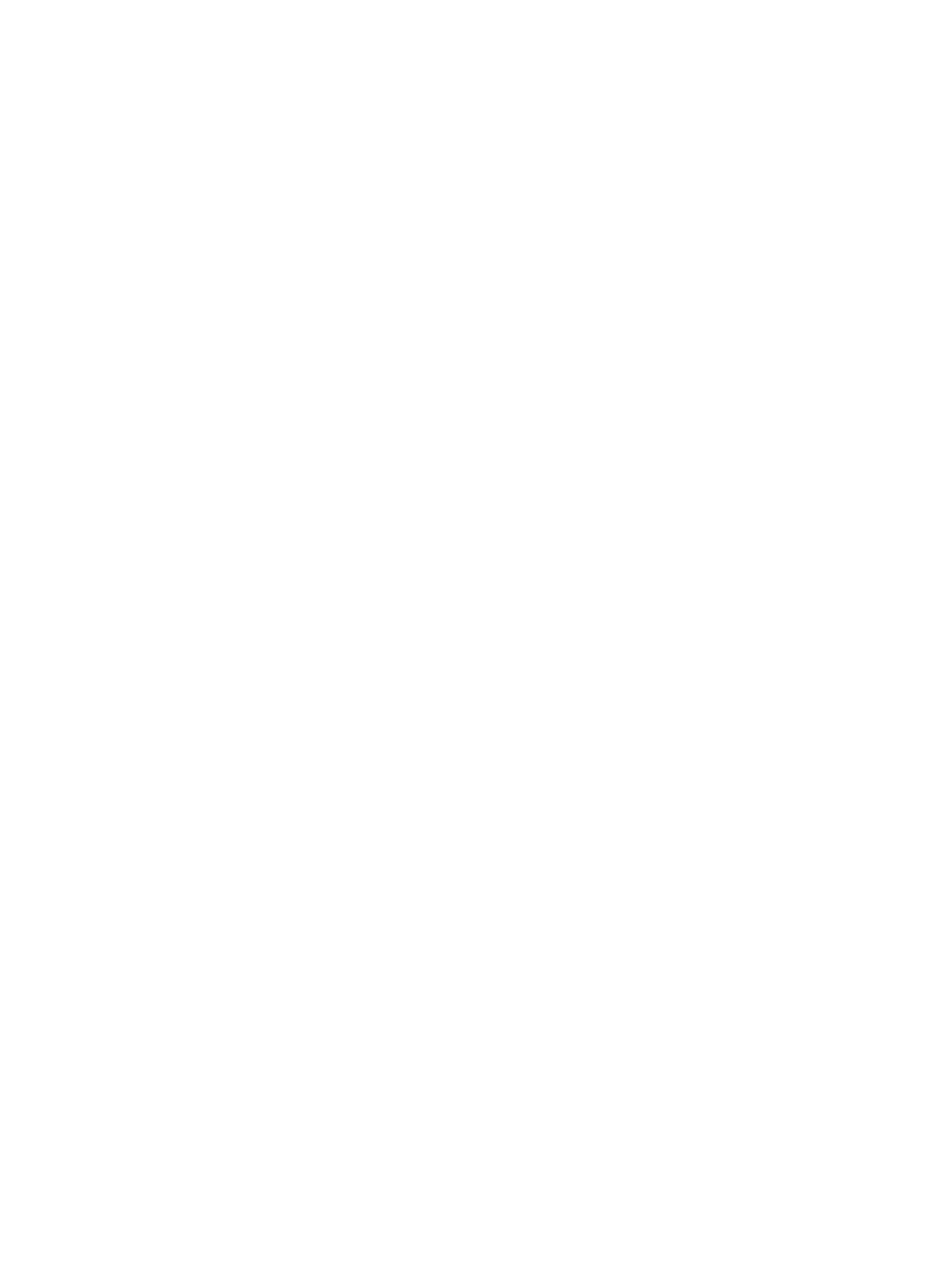Pouvez-vous présenter votre projet et pourquoi avoir créé cette initiative ?
L’Orchestre du nouveau monde est un orchestre associatif engagé pour le climat et la justice sociale. Nous souhaitons combattre les rapports de domination et de discrimination, qu’ils soient genrés, culturels, politiques ou économiques et militer pour le respect des droits humains, pour plus d’équité et de solidarité sociale et environnementale. Notre collectif est né de la volonté de créer un orchestre de résistance face aux défis du monde, en constituant une alternative au modèle dominant du monde de la musique classique. En tant que musicien-ne-s militant amateur et professionnel, étudiant et jeunes travailleurs, nous partageons tous un même objectif : bâtir un espace de réflexion ouvert et d’expérimentation de nouveaux modes d’action dans la lutte.
À destination de qui tend ce projet ?
Nous cherchons à nous adresser à un public universel, sans distinction de classe, d’âge ou de culture tout en explorant des thématiques qui résonnent profondément avec certaines préoccupations contemporaines. Notre projet vise à toucher aussi bien des amateurs de musique que des néophytes, en créant des passerelles entre les arts, les cultures et les générations. Mais il s’adresse également à des personnes potentiellement hostiles aux valeurs que nous défendons ; l’idée est d’engager un dialogue – même tacite – avec ces publics au travers de l’art, qui peut offrir un espace de réflexion, d’émotion partagée et de remise en question. Cette démarche renforce l’ambition de l’Orchestre du Nouveau Monde : être un vecteur de démocratisation culturelle tout en favorisant la rencontre et l’échange entre des sensibilités diverses.
Quels sont vos moyens utilisés pour sensibiliser les jeunes aux questions écologiques ?
Nous utilisons la musique non comme un objet sacré de beauté mais comme un objet de lutte ancré dans l’actualité. Par la désobéissance civile, nous interpellons sur des urgences actuelles avec des actions fortes, pacifiques et inélégantes. Par les manifestations, nous occupons la rue car occuper la rue, c’est occuper l’espace médiatique. L’influence est une de nos forces : grâce à notre communauté et notre visibilité, nous diffusons des messages et mettons en valeur des initiatives correspondant à nos valeurs sociales et écologistes. Par les interventions en milieu scolaire, nous faisons en sorte d’éveiller une conscience civique et environnementale chez les nouvelles générations. Ces interventions prennent tout d’abord la forme de discussions autour des notions d’engagement citoyen, de dérèglement climatique, de préservation des écosystèmes fragiles et menacés ou bien encore de préservation des droits des générations futures. Nous organisons également des interventions musicales dans lesquelles nous avons par exemple eu l’occasion de présenter notre réécriture de Pierre et le Loup (Prokofiev), conte adapté pour montrer les dégâts catastrophiques de la canicule et des incendies de forêts en usant de la pédagogie de la pièce initialement prévue pour faire découvrir aux enfants les instruments de l’orchestre.
Pouvez-vous parler de votre actualité, des divers projets qui sont en cours ?
Nous sommes actuellement dans un cycle de représentations de notre première création originale, FRACAS. À la base de ce projet, une question : comment réinventer la forme orchestrale ? Nous y tentons de représenter une autre musique classique, reconnectée au réel et productrice d’un nouvel imaginaire collectif. Nous avons pensé une histoire servant de colonne vertébrale à la création ; chaque œuvre du programme représente un tableau où les pièces sont à la fois les personnages et le décor du récit. Notre but n’est pas de produire un discours précis mais plutôt de venir interroger au travers de la musique, de faire ressentir de nouvelles sensations au public initié comme novice. Ce cycle de représentations se clôturera le 15 mars à l’UNESCO dans le cadre des Universités de la Terre.
Nous développons en parallèle un nouveau programme d’intervention en milieu scolaire sur des thèmes tels que le rapport à la nature, la place des femmes dans la musique ou la place des artistes dans la société. Nous cherchons à connecter la musique classique avec des objectifs pédagogiques précis dans des endroits où des enfants n’ont pas forcément accès à la culture et encore moins à la culture classique.
Nous accompagnerons également le 24 janvier le groupe Terrenoire à la maison de la radio, à l’occasion de la sortie de leur nouvel album “Protégé.e”, annoncé en novembre dernier.
Sur votre site, il est inscrit « l’art est la caisse de résonance d’un message engagé » Selon vous, en quoi l’art ou la musique a-t-elle une dimension politique ?
L’art, et notamment la musique – puisqu’elle est notre principale forme d’expression -, possèdent intrinsèquement une dimension politique. Loin de se limiter à l’expression esthétique ou au divertissement, la musique porte en elle une capacité à interroger les normes, à véhiculer des idées et à fédérer des individus : elle offre un langage universel qui peut toucher chacun, indépendamment de ses origines ou convictions. Cette universalité est un outil pour questionner les injustices, mettre en lumière des problématiques sociales ou encore célébrer des valeurs comme la solidarité, la paix et la diversité.
Nous croyons en la force de la culture, de l’art comme bien commun et de l’imaginaire pour émanciper et unir les esprits dans l’espoir d’un avenir plus lumineux et juste en plaçant l’empathie au cœur. En proposant des thématiques contemporaines et en engageant un dialogue avec des publics variés – y compris ceux qui pourraient être en désaccord avec les valeurs portées –, nous affirmons que l’art peut être un levier de changement et un espace de résistance. La musique devient ainsi un acte politique : non pas partisan, mais engagé dans la création de liens et la défense d’une humanité partagée.
Pour rester dans les questions larges, qu’entendez-vous par « mettre à l’honneur la contemplation des grands espaces et l’humilité face à ce qui nous dépasse » ?
Par la musique, nous souhaitons représenter les espaces naturels, dire leur importance et leur grandeur face à une société destructrice qui les met en péril. L’environnement n’est pas que ce qui nous entoure mais aussi ce qui est plus grand que nous, en taille comme en importance. Le court-métrage Glacier de Camille Etienne dans lequel nous avons eu l’honneur de jouer illustre efficacement cette démarche ; les musiciens, perdus face à l’immensité des montagnes au pied desquelles ils jouent, font monter leur voix – ou plutôt leur musique – pour sensibiliser à l’urgence climatique que représente la fonte des glaces. Cette démarche était aussi celle qui, face aux inquiétants rapports du GIEC, nous a poussé à jouer la Moldau de Smetana, poème symphonique dépeignant la rivière de Moldau (Vltava en tchèque) de sa source jusqu’à son confluent, afin de sensibiliser à la fragile préservation de l’eau et de communiquer notre humilité face à l’immensité de ces flots.