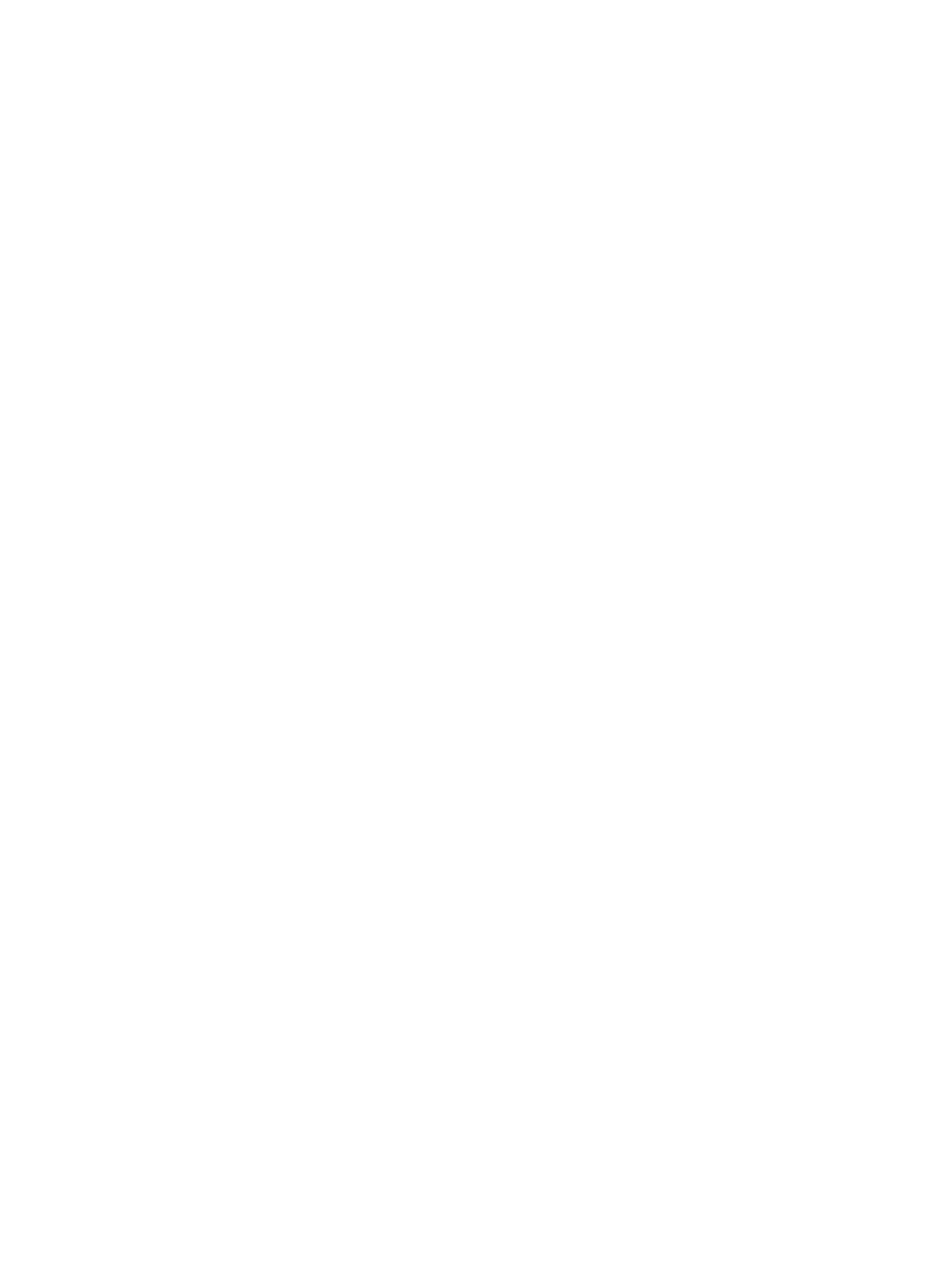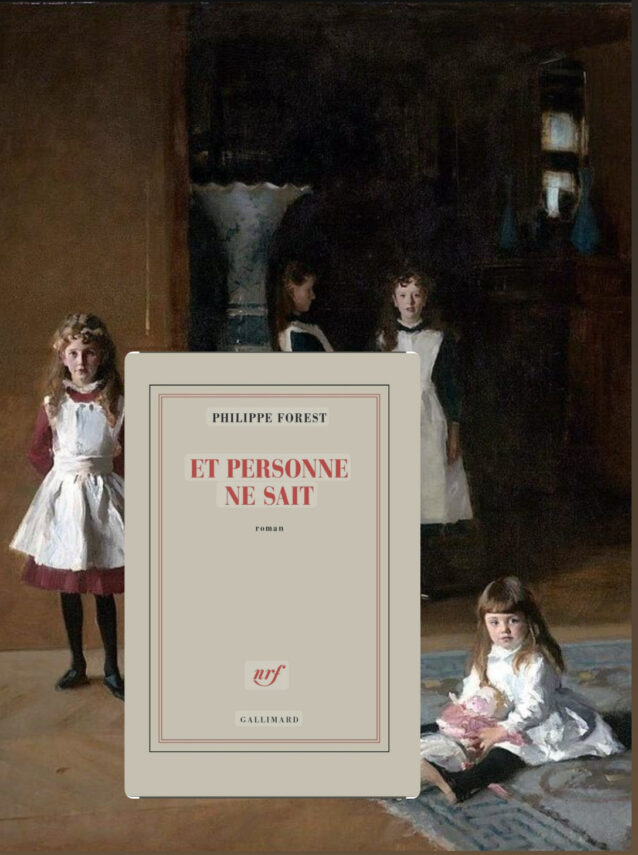Les variations Forest
Et si c’était toujours la même histoire ?
Quelle que soit la volonté de son auteur, quel que soit le processus créatif, l’énergie qui se met en mouvement lorsqu’émerge une œuvre ne le ramène-t-elle pas à la même histoire ? L’histoire originelle. La première, l’unique, la fondatrice. Un constat qui sied particulièrement à Philippe Forest, écrivain et essayiste, qui depuis maintenant une trentaine d’années raconte l’effondrement, un séisme personnel qui a bouleversé sa vie lorsque sa fille, alors petite, a quitté ce monde. Avec beaucoup de sensibilité et sans mièvrerie, il partage son histoire dans L’enfant éternel, un trait d’union entre tous ses livres, qui reprennent cette notion de perte, et qui font de la disparition le sujet central de son œuvre.
Et personne ne sait ne fait pas exception. Ce texte atypique, mi-conte, mi-rêverie, un peu essai et pourtant estampillé roman, nous entraine dans les méandres du souvenir et de la disparition. Nous voilà à New York, en 1924, l’hiver est glacial, il neige, Eben Adams est un peintre fauché, désabusé, qui ne sait plus de quoi seront faits ses lendemains. Tandis qu’il traverse Central Park, il fait une étrange rencontre, une petite fille de sept ou huit ans qui semble sortie d’outre-temps. La petite fille est seule en ce jour finissant, elle se nomme Jennie et deviendra son modèle. Un modèle insaisissable qui apparaîtra à divers moments, toujours même et pourtant autre, grandi, vieilli, enfant hier, adolescente le lendemain, femme en si peu de temps. Et à chaque rencontre, le portrait en est changé.
Philippe Forest intervient dans son roman, nous met en garde et nous invite à la magie :
« On n’est pas artiste si l’on n’est pas un peu superstitieux. Il faut croire à la magie. Elle nous dit que, à condition d’avoir la foi et de posséder la technique, ce sont les signes et les rites qui décident de tout et qui forcent le monde à prendre l’apparence que l’on imagine pour lui. Pour un écrivain, les choses obéissent aux mots qu’il prononce et, pour un peintre, le visible se conforme à l’image qu’il en prodigue. »
Ainsi la porte reste ouverte à l’interprétation. Qui est Jennie ? Un souvenir, un fantasme, une hallucination ? La mémoire est un leurre, le souvenir est discutable, la vérité n’est qu’une interprétation, Philippe Forest en fait l’exercice avec ce roman envoûtant et protéiforme où il fait dialoguer la musique, le cinéma, la peinture et la littérature. Avant de se l’approprier, Le portrait de Jennie a tout d’abord été le roman de Robert Nathan, aujourd’hui oublié, puis l’adaptation cinématographique de William Dieterle (studio MGM) en 1949. Pour Philippe Forest c’est une adaptation libre, donnant lieu à des fulgurances, des digressions, laissant les chapitres s’entrecouper par des réflexions sur d’autres œuvres du Metropolitan Museum, endroit qui devient un cadre de conte digne de Lewis Carroll décrit avec force onirisme – une demeure factice où tous les genres se mélangent et où les pendules sont arrêtées, peu ou prou à la même heure. L’endroit parfait pour Le portrait de Jennie.
C’est une lecture un peu quantique, c’est une expérience extratemporelle. C’est l’histoire d’un mystère. C’est l’éternelle question que se posent beaucoup : que deviennent les personnages nés dans la matrice d’un artiste, d’un auteur ?
D’où je viens
Personne ne le sait
Où je vais
Tout s’en va
La vague déferle
Et personne ne sait.
Philippe Forest, Et personne ne sait. Éditions Gallimard, décembre 2024, 123 pages, 17€
© NINE DESTRAC @nine_entre_les_lignes
Correction SC Les mots d’abord