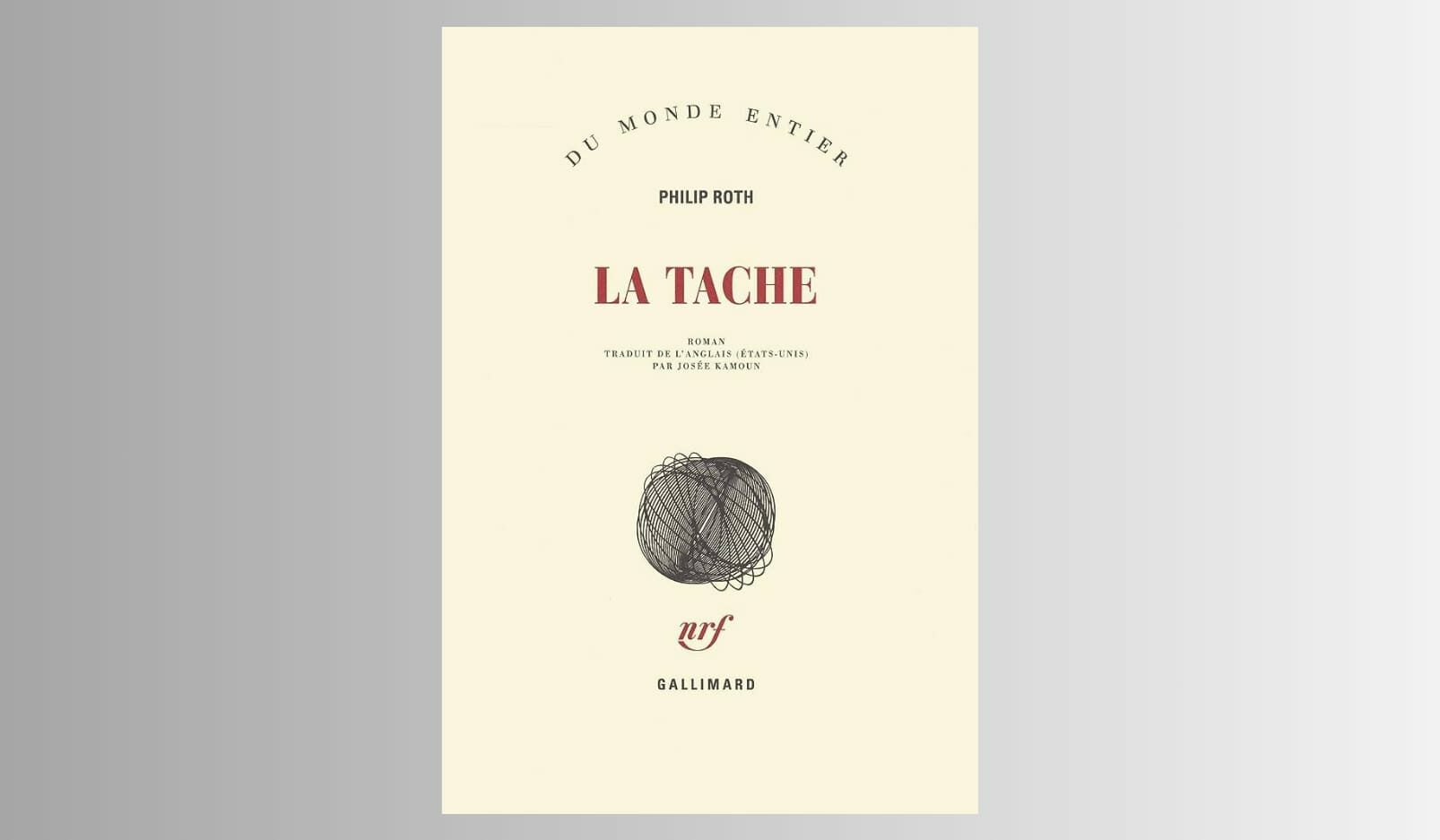La contagion par l’homme
Si Philip Roth est l’un des auteurs qui aura le plus ardemment questionné la nature humaine, il est étonnant de découvrir, au cœur de son roman La tache, une dizaine de pages au cours desquelles le romancier américain se détourne – légèrement – de son objet d’étude habituel, pour évoquer en détail l’histoire d’un oiseau. Prince (un nom qui renvoie tout de même davantage à l’humain qu’au monde animal) est une corneille vivant dans le confort d’une animalerie, loin de ses pairs, profitant des soins de la jeune fille qui tient la boutique et de l’attention de ses clients.
Pourquoi cet oiseau ? Pourquoi cette soudaine irruption du monde sauvage dans une œuvre jusqu’alors dominée par l’analyse minutieuse de l’homme dans tous ses aspects, dans toutes ses failles et dans tous ses fantasmes ?
Prince la corneille n’est pourtant pas la seule manifestation de l’imaginaire sauvage du roman. L’oiseau possède son équivalent humain, en la personne de Faunia Farley. Héroïne tragique, mère de deux enfants décédés dans l’incendie de leur maison, tourmentée par la violence des hommes, Faunia, au nom prédestiné – la « faune », est à la fois déterminée comme un buffle et fragile comme un oiseau. Le narrateur Nathan Zuckerman la décrit, la première fois qu’il la voit, éteinte et mal à l’aise, comme un être qui « réussissait à se déguiser en passe-muraille, avec l’instinct de l’animal, qu’il soit prédateur ou proie ».
Une « sagesse sauvage »
Faunia, abîmée par la vie, si différente de son amant Coleman Silk, lui le brillant professeur d’université, ancien doyen de lettres classiques, quand Faunia, elle, a arrêté l’école à quatorze ans et déclare être illettrée. Quelle meilleure preuve de sa sauvagerie, en cette fin de vingtième siècle, aux Etats-Unis, que de ne pas savoir lire ? D’autant plus qu’on apprendra plus tard que cet illettrisme est un mensonge – en affirmant qu’elle ne sait pas lire, Faunia se détourne volontairement de la connaissance, de la communication avec ses semblables, de la culture. Comme s’il s’agissait là pour elle d’un moyen de se rendre indomptable, elle qui paraît, par sa posture et par son parcours, si soumise aux hommes qui l’entourent – un leurre que Roth s’amuse habilement à détourner puisque Faunia est le personnage le plus sauvage et le plus insaisissable du roman, la preuve étant l’ensorcellement systématique des hommes qu’elle rencontre, comme s’ils devenaient envoûtés par elle et incapables de la moindre raison.
Lorsque Faunia est évoquée pour la première fois dans le roman, ce n’est pas elle qui apparaît, mais son amant qui la présente à Zuckerman, Coleman Silk parlant d’elle comme possédant une « sagesse sauvage », un oxymore curieux qu’il explicite, parlant d’une sagesse « très étroite, antisociale » – pour ainsi dire, hors des rapports humains. Faunia ne souhaite pas se mêler à ses semblables, elle se tient à l’écart, elle se tient au bord, comme si la violence qu’elle avait subie depuis son enfance l’avait conditionnée à cet instinct – sauvage – de rester sur ses gardes et de ne pas frayer avec l’Homme qui, elle le sait, n’est ni fiable ni sécurisant ; au contraire, il est même prévisible dans sa méchanceté, dans sa capacité à faire du mal, à détruire – en un mot, il est constant dans ce qu’il appellerait sa bestialité. La sagesse sauvage antisociale est une « sagesse négative » (c’est ainsi que parle Coleman Silk) si l’on considère l’humain tout puissant devant régner sur l’animal soumis ; mais Faunia nous prouve que la sagesse sauvage n’a rien de négative, au contraire, elle est simplement l’apanage de ceux qui n’ont plus confiance en l’humain et qui n’ont qu’une hâte, s’en détourner.
Et voilà Faunia, un matin, s’enfuyant de la maison de Coleman avec qui elle ne veut surtout pas s’enfermer, cet homme qui pensait pouvoir lui enseigner quelques leçons sur la nature humaine – quelle prétention, « elle savait tout ce qu’elle avait besoin de savoir sur l’histoire de la race humaine : les brutes et les sans défense » – Faunia « faussant compagnie à la race humaine » et s’arrêtant dans une animalerie pour rendre visite à Prince, la corneille.
La souillure de l’homme
Prince est un oiseau particulier – tout comme Faunia est un personnage singulier. Prince a été recueilli et élevé par les hommes, ce que ses congénères ne lui pardonnent pas. Dès que Prince sort de sa cage, qui le coupe du monde sauvage autant qu’elle le protège, dès qu’il retrouve la liberté, le voici attaqué par les autres oiseaux qui ne lui pardonnent pas sa proximité avec l’homme. Prince, au « comportement quasi humain », chassé du Paradis animal parce qu’il a eu le malheur, petit, d’être secouru par l’homme.
On assiste là à un renversement intéressant – la sauvagerie du monde animal, qu’il ne faut surtout pas chercher à idéaliser, est, dans ce cas précis, le fait de l’homme. C’est son intervention qui précipite le danger et la menace au-dessus de Prince. Et c’est Faunia, victime elle aussi de la sauvagerie humaine, qui donne la clé, non seulement du livre, mais de tout un aspect de la nature humaine : « Voilà ce qui arrive quand on a traîné toute sa vie avec des individus comme nous. C’est la souillure de l’homme. […] Nous laissons une souillure, nous laissons une trace, nous laissons une empreinte. La souillure est en chacun, inhérente, constitutive. »
Ainsi, nous sommes des créatures souillées qui ne faisons que contaminer ce qui nous entoure. La nature que nous détruisons, le Paradis dont on a été chassé, la fameuse pastorale chère à Roth est entachée par notre marque infâme, et le monde animal lui-même est perdu – non pas intrinsèquement comme on pourrait le croire, dominé par la sauvagerie et la loi du plus fort, mais par notre faute, celle de l’homme qui tache salit et infecte tout ce qu’il touche ! Le sauvage est provoqué et excité par l’homme, tout autant que l’animalité est humanisée : l’oiseau recueilli par l’homme n’est alors plus animal – en tout cas reconnu comme tel par ses semblables – et les hommes, en se brutalisant les uns les autres, deviennent sauvages et s’animalisent. La souillure avec laquelle nous naissons tous, et contre laquelle nous ne pouvons rien – elle fait partie de la nature humaine – semble ainsi se répandre, faire tache d’huile, grossissant à mesure qu’en grandissant les humains en fréquentent d’autres, et contamine jusqu’à la nature qui nous entoure.
C’est pourquoi les destins de Prince et de Faunia se rejoignent – exclus et victimes de leurs semblables. Ils finiront même, symboliquement, par s’unir, puisque la scène se conclue quand Faunia glisse dans la cage de Prince la bague que Coleman lui avait offerte. « Un corbeau qui ne sait pas vraiment être corbeau, et une femme qui ne sait pas vraiment être une femme… Nous sommes faits l’un pour l’autre. Epouse-moi. » Ainsi il n’existe plus deux mondes différents – l’humain dominant le monde animal selon une vision ethnocentrée ancestrale que Coleman symbolise, lui qui transmet à ses étudiants les leçons de l’homme antique – mais un seul et même monde où l’homme et l’animal sont égaux ensemble.
Le pouvoir destructeur de l’Homme
La nature, l’animal – tout cela contaminé par la souillure de l’homme, cette tache qui nous définit et contre laquelle nous ne pouvons pas grand-chose sinon, comme Faunia, l’accepter en nous détournant du monde humain, de nos semblables et de notre culture. L’homme « civilisé » pourra railler cette initiative, et considérer cette sagesse comme étant « sauvage », elle n’en est pas moins l’unique solution pour rapprocher les espèces. Sans quoi, tout serait perdu, tout serait détruit, par la main de l’homme intrinsèquement souillée.
Voici tout l’art romanesque de Philip Roth : disséquer l’humain jusqu’à faire apparaître ce qui est le plus profondément enfoui – son pouvoir d’annihilation, la sienne comme celle de son environnement.
La tache – Philip Roth – 2002 –
Gallimard – traduit de l’anglais par Josée Kamoun