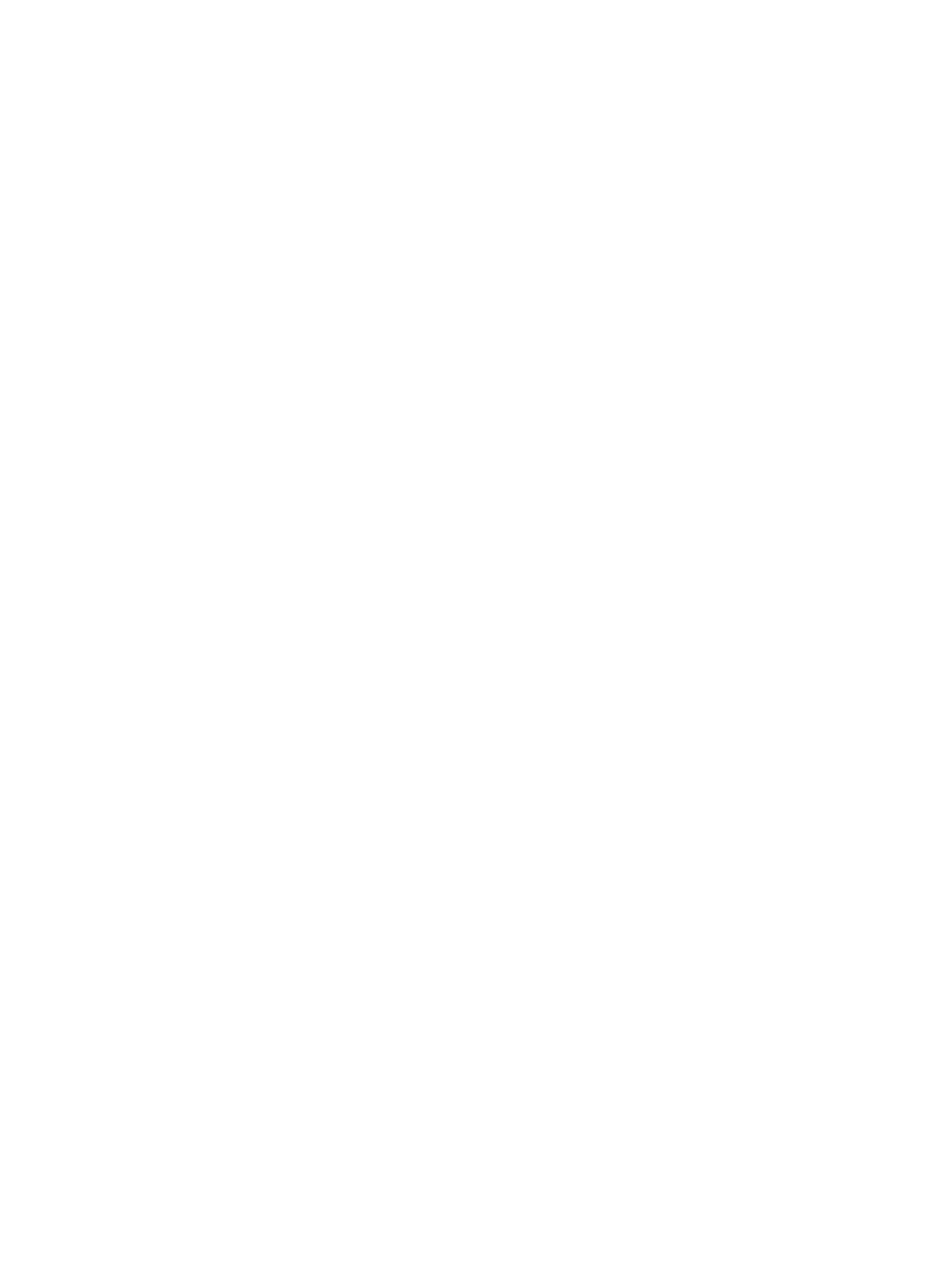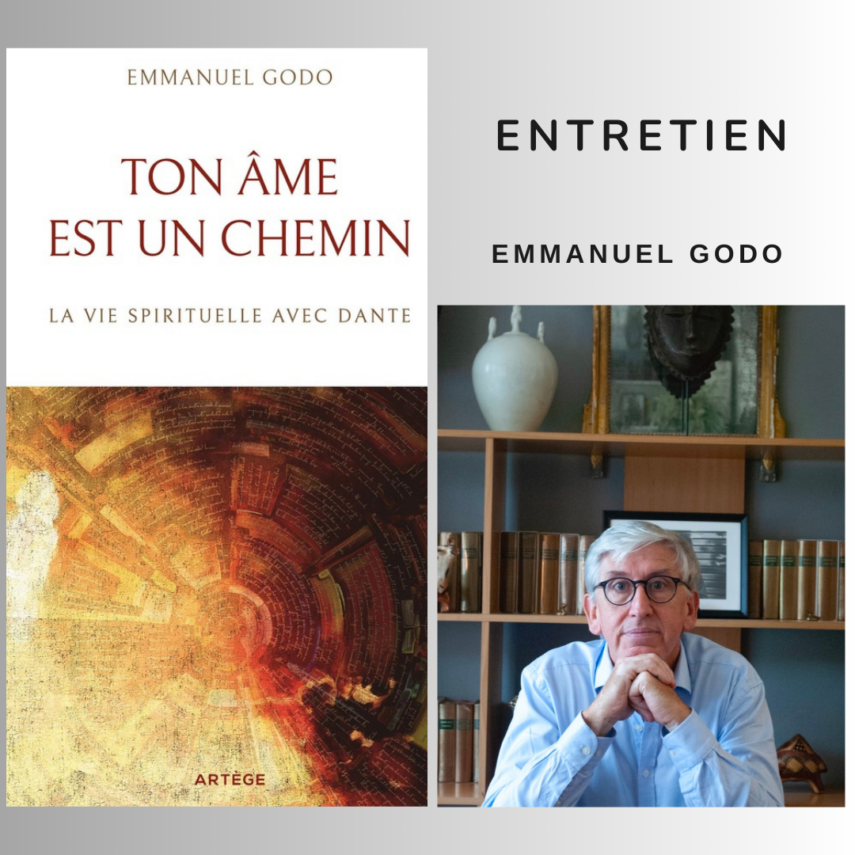Emmanuel Godo est poète et auteur d’essais consacrés à de grandes figures spirituelles de la littérature comme Léon Bloy ou Paul Claudel. Agrégé de lettres modernes, docteur ès lettres, il est professeur de littérature en classes préparatoires au lycée Henri-IV à Paris.
« Ton âme est un chemin » est l’ouvrage d’Emmanuel Godo, publié en septembre 2024 aux éditions Artège.
Un rendez-vous avec Dante à ne pas manquer.
Emmanuel Godo se plonge dans le cheminement spirituel de Dante, pour en dévoiler les résonances profondes avec les quêtes spirituelles d’aujourd’hui.
En nous invitant à le suivre, à travers sa Divine Comédie, Godo nous pousse à contempler notre propre itinéraire vers la vérité intérieure et la transcendance.
La poésie, dans son essence la plus pure, dépasse les simples mots ou les artifices de l’écrit. Elle naît dans l’expérience humaine, dans la profondeur de ce que nous vivons, ressentons et imaginons.
Pour Emmanuel Godo, « la poésie n’est pas une question de littérature, mais de vie », le poème n’est pas un simple jeu de forme, mais la naissance d’une vérité à la fois intime et universelle.
Ainsi, la lecture d’un poème, qu’il soit de Dante ou d’un autre grand poète, ne s’éteint pas avec la dernière ligne. Elle laisse une empreinte, une résonance qui continue à vibrer bien après que le livre a refermé ses pages. Ce que l’on a lu nourrit notre regard sur le monde, affûte notre sensibilité et éclaire des instants de vie, telle une lumière persistante.
Chez Dante, cette vérité prend toute sa puissance. La poésie qui traverse son œuvre ne s’épanouit pas dans le silence d’un bureau ni dans le seul désir esthétique, mais elle est le miroir vivant de son existence, de ses amours, de ses exils, de ses visions du monde et de ses quêtes spirituelles.
Qu’est-ce qui vous a poussé à revisiter La Divine Comédie de Dante à travers une réflexion sur la spiritualité contemporaine ?
Dans la société du divertissement généralisé où nous vivons, la plupart de nos contemporains vivent dans une forme d’extériorité par rapport à eux-mêmes. On les a progressivement privés de tout désir de conquête intérieure, de discipline, d’écoute véritable, de travail. L’idée même qu’ils soient des âmes a été battue en brèche au fil des deux derniers siècles. Il devait résulter de la lutte contre les effets pervers de la religion une forme de libération qui n’a jamais vu le jour : en lieu et place de l’émancipation promise, nous voyons partout le résultat désastreux de ce que le philosophe Robert Redeker (à qui est dédié le livre) a nommé l’abolition de l’âme.
J’ai très vite dans mon existence intellectuelle éprouvé le besoin de me doter de puissants contrefeux pour éviter d’être happé par la vaste machine à décérébrer et à dé-spiritualiser les êtres qui nous sert de monde. J’ai cheminé toute ma vie avec des compagnons qui se nomment Barrès, Claudel, Bloy, Pascal, Soljenitsyne, Cristina Campo, chez qui j’ai trouvé de quoi nourrir ce que j’appellerai avec Péguy ma mécontemporanéité.
Dante est le roi des poètes. Je me suis rendu compte, lors de huit années de cours donnés à Lille sur La Divine comédie, que des étudiants d’aujourd’hui, ayant un rapport plutôt lointain avec les questions spirituelles, pouvaient se passionner non seulement pour la poésie de Dante mais pour le pèlerinage intérieur auquel il invite son lecteur. Le fait que le poème de Dante soit un chemin de conversion, fait pour transformer radicalement son lecteur, n’est pas une image : c’est ce que tout lecteur bien guidé éprouve. En ce sens, je n’ai pas voulu revisiter Dante mais rendre de nouveau possible une lecture de plain-pied, qui ne serve pas à construire un savoir ou une culture générale mais à redonner à des hommes à qui l’époque vole leur âme non seulement la conscience qu’ils en ont une mais encore le désir de l’écouter et de répondre à ce qu’elle leur réclame : cheminer jusque vers Dieu, la source de tout amour.
Comment la figure de Dante peut-elle nous guider aujourd’hui dans une époque marquée par les crises et les incertitudes ?
La Divine Comédie est un poème écrit dans un pays en proie aux luttes fratricides – la guerre des Guelfes et des Gibelins – par un homme qui pense, de façon très moderne, la séparation des pouvoirs – ce qu’il nomme les « deux soleils », le gouvernement temporel dont l’Empereur a la charge, le gouvernement spirituel, qui incombe au Pape.
Le poème de Dante répond à ce qu’il considère comme une double démission : celle des princes et celle des religieux, qui devraient être tous des pasteurs d’hommes, et qui oublient leur mission au profit d’intérêts de court terme. Le poète se dresse, avec le pouvoir qui est le sien, celui du mot et de l’image, pour offrir à ses contemporains et à toute l’humanité à venir un moyen de ne pas passer à côté de leur destinée. Qui oserait dire que cette responsabilité du poète n’a plus lieu d’être ?
Dante est à la fois un homme du Moyen-Âge, à la fois il ouvre la voie à la Renaissance et, même, à la Réforme religieuse. La Divine comédie est écrite sur une ligne de faille civilisationnelle. C’est un texte qui vient nous chercher là où nous sommes les plus en demande, les plus assoiffés, le plus vulnérables, donc les plus authentiquement vivants. Dante ne parle pas depuis une posture de surplomb, mais dans une proximité, une humilité absolue, qui est la condition de la parole vraie : il se met en scène perdu dans la forêt obscure, c’est-à-dire dans l’erreur qui se répète à tout âge et qui menace tout individu : se contenter, comme aliment spirituel, des produits de l’époque. Le poème de Dante revêt une dimension maïeutique. Il ne se contente pas de raconter un voyage dans l’au-delà : il le fait vivre au lecteur. Et l’au-delà n’est pas un espace imaginaire : c’est en nous que le voyage a lieu. L’enfer est en nous, c’est l’emprise sur nous des faux biens, des illusions, des erreurs morales. Comme le purgatoire, le lieu de la lutte. Et comme le Paradis, le lieu de la réconciliation avec Dieu.
Quel rôle joue la dimension spirituelle dans une société qui valorise souvent plus le matériel que l’intangible ?
Beaucoup de nos contemporains sont perdus. La plupart sont passifs, endormis spirituellement, lessivés par le flux incessant des images. Prêts à se donner au premier diseur de slogan qui passe. Le travail intérieur est l’œuvre d’une vie, il demande des forces que nos contemporains consacrent au divertissement, à la consommation, au travail frénétique, sans implication et sans signification profondes. Rimbaud nous a prévenus à la toute fin d’Une saison en enfer : « Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes » et c’est un combat sans répit car « la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul ». La société dans laquelle nous vivons nous fait vivre nos vies à la plus basse puissance.
Dante, comme tout poète digne de ce nom, nous rappelle que notre âme est semblable à une soif : elle veut l’amour de son créateur, d’où elle procède et où elle fait retour. Toutes les réponses que nous lui donnons, si elles ne sont pas l’écho fidèle de cet amour premier, infini, sont condamnées à nous décevoir, à nous attrister.
La Divine Comédie n’appartient pas au passé : le poème de Dante se dresse, à toutes les époques, comme un moyen d’échapper au Néant. La machinerie négative fonctionne aujourd’hui à plein régime. Mais des contrefeux s’allument un peu partout, ce qui est une source d’espérance.
Vous écrivez que l’âme est souvent oubliée ou négligée dans nos vies modernes. Quels sont, selon vous, les symptômes de cette négligence ?
La principale à mon sens est la négligence elle-même. Au sens étymologique du lien que l’on coupe. Ce qui en découle est une inattention, qui prend souvent la forme d’une fausse curiosité, aujourd’hui. On croit s’intéresser, on vient humer, on tâte, on consomme. Mais de là à se laisser dérouter, à faire authentiquement silence, à accepter de se laisser transformer par la lumière entrevue ! On voudrait bien avoir avec notre âme le même rapport de distraction qu’on a avec le monde. La plupart de nos contemporains vivent à côté d’eux-mêmes. On les a conduits, progressivement, à tout externaliser, à se déresponsabiliser de l’essentiel : le rapport à la finitude, à la souffrance, à l’angoisse, à la mort. Le grand fantasme d’aujourd’hui, c’est le tout-en-un, le pack. Si l’on pouvait les délivrer du tragique, de l’angoisse de la mort, les contemporains seraient prêts à signer tous les pactes faustiens possibles et imaginables. Avec la technique, encore et toujours. Avec une science qui se pense sans limite. Des pouvoirs qui eux-mêmes ne tolèrent plus de borne.
On croit lire mais la véritable lecture commence quand on entre dans un silence plus grand que nous. Qu’on trouve, en nous, la marque d’une gravité qui nous fait éprouver l’insuffisance des formes que nous donnons à nos existences. Lorsque nous dépassons la question du plaisir, de l’intérêt ou du contentement pour nous retrouver dans une forme de nudité, de pauvreté indépassable. Là où aucun masque ne tient, aucun savoir de circonstance, aucun orgueil dont on puisse se prévaloir : là où commence notre visage, là est notre âme. Quelque part dans l’intenable et dans l’inconsolable.
Chez Dante, c’est la conscience de la perte de Béatrice – pas seulement la mort de la femme aimée, mais la prise de conscience qu’il n’a pas su voir qui elle était, de quel amour elle était le visage. L’impression d’exil qui en découle est pire encore que celui qui provient de l’arrachement à la cité-mère, Florence.
Dans votre livre, vous introduisez une jeune femme qui dialogue avec Dante. Pourquoi avoir choisi cette approche narrative ?
Ce livre est d’abord un hommage à l’acte d’enseignement des lettres, à l’amour qui est y est à l’œuvre. Amour des grands livres, de cette patrie immortelle qu’ils offrent aux mortels que nous sommes, comme dirait Hannah Arendt. Amour, aussi, pour ces esprits qui s’éveillent, chez les jeunes gens. Dont on mésestime trop souvent aujourd’hui les attentes, les soifs en souffrance.
La jeune femme du livre me permettait d’échapper au spectre du commentaire savant. Non que je m’en méfie – je le pratique et je connais sa nécessité et même sa noblesse – mais je voulais que Dante ne soit pas réservé au Savoir, qu’il puisse être redonné à tout lecteur désireux de comprendre, de reprendre les fils dénoués de l’histoire sacrée.
La figure de la jeune femme introduit une dimension dialogique, des questions, des étonnements, des réticences parfois. Le chef-d’œuvre peut se trouver pris en tenaille par deux écueils : soit le muséifier, soit l’actualiser à outrance. Le dialogue avec la jeune femme permet, je l’espère, d’échapper à ces deux obstacles et de redonner à entendre le poème de Dante dans sa force originelle. Il nous parvient avec une vitalité étonnante – à bien des égards il est, comme toute poésie accomplie, en avant sur l’Histoire que nous vivons. Dante vient du passé mais La Divine Comédie, en tant que poème, est toujours devant nous, comme un destin à assumer, à mettre en œuvre dans nos vies.
Votre écriture dans Ton âme est ton chemin est très poétique. Était-ce un choix délibéré pour accompagner le sujet de l’âme ?
Je suis poète. Il y a un cercle vertueux propre à la poésie : le poète, par son rapport au monde et au langage, est capable d’entrer dans le vif du poème, de ne pas interposer entre lui et nous une chape de représentations ou de concepts qui viendraient le tenir à distance. Baudelaire l’a formulé d’une manière définitive : le poète devient fatalement critique.
Et la force d’un poème comme celui de Dante est de nous apprendre à le lire, de nous éveiller, de nous disposer, au fur et à mesure, à mieux l’entendre. À regarder, comme aurait dit Claudel, dans la même direction que lui. Si l’écriture du commentateur se fait elle-même poétique, c’est par l’effet de cette contamination heureuse. Nous ne nous contentons pas d’analyser, nous faisons au poème la promesse de suivre le sillon qu’il trace en nous.
La poésie n’est pas affaire de littérature, mais de vie profonde. Le poème, dans la vie de Dante, commence bien avant l’acte d’écrire, et se poursuit, en nous, bien après l’acte de lecture.
C’est un sillon d’amour, qui demande que les mots se mettent à son écoute. Et que nos vies s’accordent à sa musique.
Si Dante touche autant les âmes ardentes de tous les temps, les chercheurs d’absolu, c’est que ce qu’il écrit de l’amour, de la liberté comme don divin, de la recherche de la justesse intérieure, est implacablement vrai. Poésie est vérité.
Quels auteurs ou œuvres littéraires ont influencé votre manière d’écrire ce livre ?
Je me suis initié à Dante, d’abord en lisant les grands dantologues comme Alexandre Masseron, John Freccero ou Carlo Ossola. Mais aussi en lisant les écrivains qui ont été marqués par Dante, Saint-John Perse, Claudel, Barrès. Mais il fallait, surtout, écouter la voix de Dante. Ne pas se laisser submerger ou impressionner par la somme des commentaires. Dante est un homme de son temps, il pense par allégories, il connaît parfaitement la Somme théologique de Saint Thomas d’Aquin. Il fallait être au diapason de son monde pour comprendre à quel point le chemin qu’il propose dépasse son paysage premier.
Le génie créateur consiste, à partir de la langue de son temps, à trouver le moyen de parler la langue de tous les temps. Comme s’il y avait, au sein de l’odyssée humaine, un invariant, le cœur ardent de la quête. Qui fait que nous pouvons nous sentir, profondément, intensément, le contemporain de Dante. J’ai essayé, avec mes moyens propres, mon histoire singulière, ma bibliothèque imaginaire qui passe par Hugo, Bloy, Bernanos, tant d’autres, d’écrire là, dans ces parages.
Ton âme est un chemin La vie spirituelle avec Dante, Emmanuel Godo , 320 pages, 18,90 €
Date de parution : 18.09.2024
Site : emmanuel-godo.com
Photographie ©Mathilde Chèze
© SOPHIE CARMONA Janvier 2025